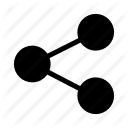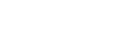Les écarts de santé touchent particulièrement les personnes issues de l’immigration qui sont plus affectées par l’exclusion sociale. Au sein de ce groupe, les personnes réfugiées et migrantes à statut précaire sont plus susceptibles de vivre des inégalités matérielles et sociales ainsi qu’être limitées dans l’exercice de leurs droits dans la société.
Afin de rendre disponibles plus de connaissances à ce sujet, la Direction de santé publique (DSPuplique) du CIUSSS de la Capitale-Nationale est heureuse de diffuser le rapport de recherche Migration et santé: comprendre le contexte et l’expérience de personnes réfugiées, demandeuses d’asile et sans statut pour viser l’équité en santé.
Des objectifs permettant de viser l’équité en santé
Ce rapport permet de :
- résumer le contexte fédéral et provincial de l’immigration, des responsabilités des gouvernements, des statuts d’immigration ainsi que de l’accès aux services publics selon certains statuts migratoires;
- contribuer à une meilleure compréhension des contextes prémigratoires, des trajectoires migratoires et des conditions de vie de personnes réfugiées, demandeuses d’asile et sans statut vivant dans la Capitale-Nationale;
- identifier les problèmes d’accès aux services de santé et aux services sociaux des personnes réfugiées, demandeuses d’asile et sans statut vivant dans la Capitale-Nationale;
- proposer des pistes d’action afin de réduire les inégalités sociales de santé pour les personnes réfugiées et les personnes migrantes à statut précaire de la Capitale-Nationale.
Une démarche participative
S’appuyant sur des approches reconnues pour réduire les inégalités sociales de santé, la production de ce rapport a privilégié une approche axée sur :
- la collaboration et la participation des personnes réfugiées, demandeuses d’asile et sans statut vivant dans la Capitale-Nationale;
- les expériences, le vécu et les représentations des personnes réfugiées, demandeuses d’asile et sans statut, en plus des données statistiques et du point de vue des experts. Cette approche vise notamment à comprendre comment se construisent les inégalités sociales de santé auprès de ces trois groupes dans la Capitale-Nationale.
Ce rapport permet de donner une voix à celles et ceux qui n’ont pas ou peu de place dans l’espace public afin de se faire entendre et reconnaître.
Quelques faits saillants
- Le statut migratoire d’une personne dans un pays d’accueil détermine ses droits, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ainsi que la place qu'elle pourra occuper dans la société. Un statut d’immigration précaire la plonge dans l’incertitude et la crainte quant à son droit de résider, d’étudier et de travailler au Canada.
- Plus le statut de migration est précaire, plus la participation sociale est restreinte. Les conditions de vie deviennent alors plus difficiles et les risques d’abus et de violence augmentent. De plus, l’accès aux différents services est davantage limité.
- Les processus d’exclusion sociale affectent plusieurs personnes en fonction de plusieurs facteurs, tels que leur sexe, leur genre, leur revenu, leur emploi, leur scolarité, leur appartenance à une minorité ethnoculturelle, la présence d’une limitation fonctionnelle, leur orientation sexuelle, etc.
- L’exclusion sociale se vit notamment dans les familles, dans les immeubles locatifs, dans les milieux d’éducation et les milieux de travail, ou encore dans les services publics comme les services de santé et le système judiciaire.
- La majorité des personnes ayant participé à cette étude ont fait l’objet de mépris identitaire. Les marqueurs culturels, tels que la couleur de la peau, l’apparence ethnique, la langue étrangère ou encore le port de symboles religieux, influencent leurs relations avec les autres personnes de la société et leurs rapports avec les organisations.
- Si de nombreux réfugié(e)s et migrant(e)s sont relativement en bonne santé, d’autres arrivent avec un état de santé physique et psychologique fragilisé dû aux conditions de vie difficiles de leur pays d’origine, des pays de transit, des camps de réfugiés et de la route de l’exil.
- Selon les propos recueillis, on constate que les conditions de vie du pays d’accueil peuvent être bien ou mal perçues selon le statut de migration et la perspective des personnes rencontrées. Une personne migrante ayant vécu plusieurs années dans un camp perçoit généralement de meilleures conditions de vie dans son pays d’accueil. Au contraire, une personne qui détenait un statut socioéconomique élevé dans son pays d’origine fait face à des conditions de vie perçues comme plus difficiles en arrivant au Québec.
- L’exclusion sociale et la précarité du statut migratoire peuvent entraîner des impacts négatifs sur la santé physique et mentale.
- Le statut migratoire précaire et l’absence de statut rendent les abus et les violences vécus invisibles au sein de notre société. Ces abus ont également des impacts importants sur la santé physique et psychologique. La violence sous toutes ses formes est une atteinte à la sécurité et aux droits fondamentaux.
Des recommandations permettant de viser l’équité en santé
Nos façons de travailler devraient reposer sur ces trois principes phares :
- la concertation, la collaboration et le partenariat de chaque acteur;
- la participation citoyenne et celle des communautés;
- le pouvoir d’agir des personnes et des communautés.
De plus, pour contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé, nos actions devraient s’appuyer sur cinq orientations distinctes :
- L’élaboration de politiques publiques qui visent l’équité dans tous les secteurs de la société;
- La lutte contre l’exclusion sociale sous ses diverses formes et dimensions;
- La mise en place de conditions de vie favorables à la santé;
- Le renforcement des actions communautaires et l’appui des organismes communautaires;
- L’augmentation de la sensibilité ainsi que le renforcement des capacités du réseau de la santé et des services sociaux afin de répondre aux besoins des personnes réfugiées et des personnes migrantes à statut précaire.